Source : https://www.terrestres.org/2023/09/29/les-deux-piliers-de-lecosocialisme-democratique/
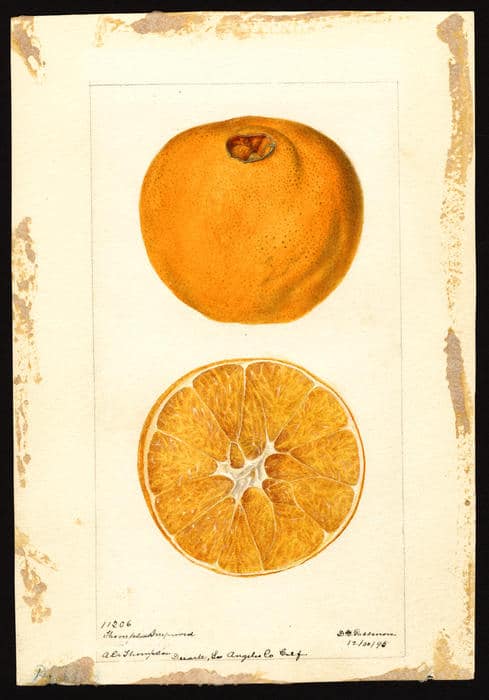
Temps de lecture : 13 minutes
Cet article a été initialement publié dans Monthly Review en septembre 2022. Il est traduit par Pierre de Jouvancourt.
En ce début de XXIe siècle, nous faisons face à une double crise. D’un côté, il s’agit d’une crise écologique : le changement climatique et d’autres pressions exercées sur le système Terre outrepassent dangereusement les limites planétaires. D’un autre côté, nous avons affaire à une crise sociale : plusieurs milliards de personnes sont privées d’un accès aux biens et aux services de première nécessité. Plus de 40% de la population humaine n’a pas les moyens de se procurer une alimentation nutritive ; 50% est dépourvue d’installations sanitaires sûres ; 70% n’ont pas accès aux soins de santé essentiels.
La privation est plus intense à la périphérie de l’économie mondiale, là où les dynamiques impérialistes d’ajustement structurel et d’échange économique inégal perpétuent la pauvreté et le sous-développement. Mais cette dépossession est également flagrante au centre : aux Etats-Unis, presque la moitié de la population ne peut s’offrir de soin de santé ; au Royaume-Unis, 4,3 millions d’enfants vivent dans la pauvreté ; dans l’Union Européenne, 90 millions de personnes vivent dans l’insécurité économique. En outre, ces structures de privation s’entrecroisent avec de brutales inégalités de race et de genre.
Aucun programme politique promettant d’analyser et de résoudre la crise écologique ne peut espérer un quelconque succès s’il ne s’attaque en même temps à la crise sociale. Ne répondre exclusivement qu’à l’une de ces crises ne fait que renforcer l’autre et finira par faire naître des monstres. Et déjà, sous nos yeux, les monstres sont en train d’apparaître.
Il est essentiel de comprendre que la double crise sociale et écologique est provoquée, en définitive, par le système de production capitaliste. Les deux dimensions de la crise sont les symptômes de la même pathologie sous-jacente. Par capitalisme, je ne veux pas seulement désigner les marchés, le commerce et les affaires comme tant de gens le pensent habituellement. Ces choses ont existé depuis des millénaires avant le capitalisme et sont plutôt inoffensives en elles-mêmes. Ce qui distingue le capitalisme et ce à quoi nous devons nous confronter est sa nature fondamentalement antidémocratique, sans laquelle il ne pourrait exister.
Oui, nous sommes nombreux et nombreuses à vivre au sein de systèmes politiques fondés sur l’élection – aussi corrompus et biaisés fussent-ils – où nous choisissons régulièrement des dirigeant·es politiques. Mais lorsqu’il s’agit du système de production, pas la moindre apparence de démocratie n’intervient. Le capital la contrôle presqu’exclusivement : je pense aux grandes entreprises, aux grandes sociétés financières et aux 1% qui détiennent la plus grande partie des actifs investissables. Le capital détient le pouvoir de mobiliser notre travail et les ressources de notre planète pour réaliser ce que bon lui semble, et de ce fait décide de ce que nous produisons, à quelle condition et comment le surplus que nous générons devrait être utilisé et distribué.
Lire sur Terrestres, Michael Löwy, Bengi Akbulut, Sabrina Fernandes, Giorgos Kallis, « Pour une décroissance écosocialiste », octobre 2022.
Permettez-moi d’être le plus clair possible : pour le capital, l’objectif primordial de la production ne consiste ni à répondre aux besoins fondamentaux, ni à réaliser un quelconque progrès social, et encore moins à mettre en œuvre des mesures écologiques concrètes. Bien plutôt, son objectif principal est-il de maximiser et d’accumuler du profit.
De ce fait, le système-monde capitaliste se distingue par des formes de productions perverses. Le capital oriente la finance vers des produits très rentables, comme les SUV, la viande industrielle, la fast fashion, les armes, les combustibles fossiles et la spéculation immobilière. Dans le même temps, il produit et reproduit des pénuries chroniques de biens et de services essentiels, comme le transport et la santé publics, l’alimentation de qualité, les énergies renouvelables et les logements abordables. Ce processus a lieu dans les économies nationales mais possède également des dimensions impérialistes évidentes. La terre, le travail et les capacités productives du Sud Global sont contraints d’alimenter les chaînes mondiales de marchandises dominées par les entreprises du Nord – qu’il s’agisse des bananes pour Chiquita, du coton pour Zara, du café pour Starbucks, des smartphones pour Apple ou encore du cobalt pour Tesla. Tout cela se fait au bénéfice du centre, à des prix dépréciés artificiellement, et au détriment de la production de nourriture, de logement, de soin, d’éducation et de biens répondants aux besoins nationaux. L’accumulation du capital au centre de l’économie-monde repose ainsi sur le siphonnage de la force de travail et des ressources de la périphérie.
Il devrait être donc évident que la pauvreté reste un phénomène très répandu dans une économie mondiale capitaliste, en dépit d’un haut volume de production global – et d’énergie et de matériaux dont les effets écologiques se situent bien au-delà des limites soutenables de la planète. Oui, le capitalisme produit trop, mais aussi pas assez de ce qu’il faut. La marchandisation réduit l’accès aux biens et aux services essentiels ; et, en cherchant toujours à rendre le travail moins coûteux, en particulier dans la périphérie, la consommation des travailleurs et des travailleuses se trouve amoindrie.
Il y a plus de 130 ans, Pierre Kropotkine avait déjà souligné ce processus. Dans La Conquête du pain, il remarquait qu’en dépit des hauts niveaux de production en Europe au XIXe siècle, la majeure partie de la population vivait dans la misère. Pourquoi ? Parce que dans un régime capitaliste, la production est mobilisée pour ce « ce qui promet les plus grands bénéfices à l’accapareur »1. « Une minorité », écrivait-il, s’arroge le droit de « gouverner la vie économique de la nation. » Pendant ce temps, les masses qu’on empêche de subvenir à leurs propres besoins par leur propre travail n’ont « point devant elles de quoi vivre un mois ou même huit jours. »
Considérez, insistait Kropotkine, tout ce « travail en pure perte : ici pour maintenir l’écurie, le chenil et la valetaille du riche, là pour répondre aux caprices des mondaines et au luxe dépravé de la haute pègre ; ailleurs pour forcer le consommateur à acheter ce dont il n’a pas besoin, ou lui imposer par la réclame un article de mauvaise qualité ; ailleurs encore, pour produire des denrées absolument nuisibles, mais profitables à l’entrepreneur. »
Mais toute cette activité productive pourrait être organisée vers d’autres fins. « Ce qui est gaspillé de cette façon », écrivait Kropotkine, « suffirait pour doubler la production utile, ou pour outiller des manufactures et des usines qui bientôt inonderaient les magasins de tous les approvisionnements dont manquent les deux tiers de la nation. » Si les travailleur·ses et les paysans avait le contrôle sur les moyens de production, ils et elles pourraient facilement se rendre capable de garantir ce que le penseur anarchiste nommait « le bien-être pour tous ». Il serait alors possible de mettre fin à la pauvreté de masse, le dépouillement et les pénuries organisées qui sont la marque du capitalisme.
L’argument de Korpotkine est toujours valide aujourd’hui. Une petite partie de la capacité de production mondiale suffirait à garantir une vie décente à tou·tes les habitant·es de la planète. Mais la crise écologique nous impose un autre défi que Kropotkine ne pouvait pas, à son époque, anticiper à sa juste mesure. En effet, il nous faut atteindre le bien-être pour toutes et tous et en même temps réduire l’utilisation d’énergie et de matière (en particulier au centre de l’économie-monde) de telle sorte à décarboner rapidement nos modes de vie et à ramener l’économie mondiale dans les limites planétaires. L’innovation technologie et les gains d’efficacité sont centraux pour atteindre cet objectif, mais les pays à haut niveau de revenu doivent également diminuer les productions les moins essentielles afin de réduire directement l’utilisation excessive d’énergie et de matière.
Si le capitalisme n’a jamais été capable d’accomplir le premier objectif (le bien-être commun), il est certain qu’il ne peut accomplir le second. C’est structurellement impossible dans la mesure où il va à l’encontre de la logique fondamentale de l’économie capitaliste, qui consiste à faire croître indéfiniment la production globale afin de maintenir les conditions de l’accumulation perpétuelle.
Ce que nous devons faire coule de source : nous devons mettre en place un contrôle démocratique sur la finance et la production, comme Kropotkine le disait, et nous devons désormais l’organiser à partir d’un double objectif associant bien-être et écologie. Pour cela nous avons besoin de distinguer, comme il le faisait, la production socialement nécessaire devant clairement augmenter pour le progrès social, d’avec les formes de production destructrices et moins essentielles, qui, elles, doivent urgemment diminuer. Tel est l’épreuve révolutionnaire, d’ampleur mondiale et historique, à laquelle notre génération fait face.
A quoi ressemblerait une telle économie ? Plusieurs objectifs clé se dégagent.
Pour assurer la cohésion sociale, nous devons tout d’abord étendre et dé-marchandiser les services publics universels. Par ces derniers je veux dire la santé et l’éducation, oui, mais aussi le logement, le transport public, l’énergie, l’eau, Internet, la puériculture, les infrastructures récréatives et l’alimentation saine pour toutes et tous. Mobilisons nos forces productives afin de garantir à chacun et chacune un accès aux biens et aux services nécessaires au bien-être.
Deuxièmement, nous devons mettre en place des programmes de travaux publics ambitieux, afin de construire un réservoir d’énergies renouvelables, d’isoler les logements, de produire et d’installer des appareils sobres, de restaurer les écosystèmes et d’innover en matière de technologies socialement nécessaires et écologiquement efficaces. Ce sont des politiques d’intervention essentielles qui doivent être réalisées le plus rapidement possible ; nous ne pouvons pas attendre poliment que les capitaux décident qu’elles valent la peine d’être réalisées.
Troisièmement, nous devons introduire une garantie à l’emploi public qui soit en mesure de rendre les gens capables de participer à ces projets collectifs vitaux, en réalisant un travail à la fois sensé et socialement nécessaire, associé avec des conditions d’exercice sur lesquelles ont un pouvoir collectif, ainsi que des salaires décents. Cette garantie à l’emploi doit être financée par le créateur de monnaie, mais elle devrait être contrôlée démocratiquement à l’échelle locale appropriée.
Considérez la puissance de cette approche. Elle nous permet d’atteindre des objectifs écologiquement nécessaires. Mais elle abolit aussi le chômage. Elle abolit la précarité économique. Elle garantit de bonnes conditions de vie pour toutes et pour tous indépendamment des fluctuations de la production globale, rompant ainsi le lien entre bien-être et croissance. En ce qui concerne le reste de l’économie, les grandes entreprises devraient être démocratisées et soumise à un contrôle des travailleur·ses, et des communautés le cas échant, et la production devrait être réorganisée autour des objectifs de bien-être et d’écologie.
Ensuite, pendant que nous consolidons et que nous améliorons les secteurs d’activités nécessaires sur les plans écologique et social, nous devons faire en sorte de diminuer les formes de production les moins socialement nécessaires. Les énergies fossiles constituent en cela un cas évident : nous devons fixer des objectifs contraignants afin de faire disparaître cette industrie progressivement, d’une manière équitable et juste. Cependant, comme le montre les études sur la décroissance, nous avons également besoin de réduire la production globale dans d’autres secteurs industriels destructeurs (voiture, aviation, logements de luxe, viande industrielle, fast fashion, publicités, armes de guerre, etc.), tout en augmentant la durée de vie des objets et en abolissant l’obsolescence programmée. Ce processus doit être défini de manière démocratique, mais aussi fondé sur la réalité matérielle et écologique et sur les impératifs de la justice décoloniale.
Lire sur Terrestres, Timothée Parrique, Giorgos Kallis, « La décroissance : le socialisme sans la croissance », février 2021.
Enfin, il est on ne peut plus urgent de réduire le pouvoir d’achat des riches par le biais d’impôts sur la fortune et de plafonds sur les revenus élevés. En ce moment même, les millionnaires à eux-seuls sont sur le point de brûler 72% du budget carbone restant pour ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement global. Ce seul fait constitue une injure criante à l’encontre de l’humanité et du vivant, et personne ne devrait l’accepter. Il est irrationnel et injuste de continuer à détourner notre énergie et nos ressources pour soutenir une élite ultra-consommatrice en pleine catastrophe écologique.
Si, après avoir mis en place ces mesures, nous nous rendons compte qu’il nous faut moins de travail pour produire ce dont nous avons besoin, nous pourrons alors raccourcir sa durée hebdomadaire, offrir aux gens davantage de temps libre et partager le restant indispensable encore plus équitablement de manière à se prémunir durablement du chômage.
La dimension internationaliste de cette transition doit figurer au premier plan. L’utilisation excessive d’énergie et de matière doit diminuer aux centres de l’économie-monde pour atteindre les objectifs écologiques, tandis que les périphéries doivent restaurer et réorganiser leurs capacités productives. Et, dans bien des cas, ces dernières doivent même être augmentées pour répondre aux besoins humains et se développer, afin que les flux de production convergent au niveau global à des niveaux qui soient à la fois suffisants pour le bien-être de tous et toutes et compatibles avec la stabilité écologique.
Pour le Sud Gobal, cela nécessite de mettre un terme aux programmes d’ajustement structurels, d’annuler les dettes externes, de garantir la disponibilité universelles des technologies essentielles et de permettre aux gouvernements de mettre en place des politiques industrielles et fiscales progressives dans le but de renforcer la souveraineté économique. En l’absence d’une action réellement multilatérale, les gouvernements du Sud peuvent et devraient, de manière unilatérale ou collective, prendre des mesures pour mettre en œuvre un développement souverain et devraient être soutenus pour cela.
Tous ces éléments devraient maintenant clarifier ce point : on comprendra mieux l’idée de décroissance, à savoir le cadre théorique qui a ouvert l’imagination des scientifiques et des activistes depuis une décennie, si on l’inscrit plus largement dans la lutte pour l’éco-socialisme et l’anti-impérialisme.
Le programme que je viens de décrire est-il économiquement abordable ? Oui. Par définition, oui. Comme l’a même reconnu John Maynard Keynes, cet influent économiste capitaliste, et comme l’ont toujours compris les économistes socialistes, tout ce que nous pouvons réaliser, en termes de capacité de production, nous pouvons le payer. Et en matière de capacité de production, nous en avons bien plus qu’il n’en faut. En établissant un contrôle démocratique sur les finances et la production, nous pouvons simplement réorienter l’utilisation de cette capacité du gaspillage et de l’accumulation élitiste vers des objectifs sociaux et écologiques.
Certain·es diront que tout cela est utopiste. Mais il se trouve que ces politiques sont extrêmement populaires. Des services publics universels, une garantie publique à l’emploi, plus d’égalité, une économie centrée sur le bien-être et l’écologie plutôt que la croissance : les sondages et les enquêtes montrent qu’il y a un soutient majoritaire pour ces idées et les assemblées officielles de citoyens de plusieurs pays sont appelé précisément à ce genre de transition. Nous avons là quelque chose qui a le potentiel de devenir un agenda politique populaire et réalisable.
Mais rien de tout cela n’arrivera tout seul. Cela nécessitera une lutte politique d’envergure contre celles et ceux qui tirent outrageusement bénéfice du statut quo. Le temps n’est plus au réformisme mou, aux retouches sur les bords d’un système défaillant. Le temps est au changement radical. Mais il est clair, cependant, le mouvement écologiste récent ne peut en constituer le seul moteur. Même s’il est vrai qu’il a réussi à mettre au premier plan les problèmes écologiques dans l’espace public, il ne dispose pas des capacités d’analyse structurelle et l’influence politique pour réaliser la transition dont nous avons besoin. Les partis verts bourgeois sont en cela particulièrement révélateurs, avec leur inquiétante ignorance des modes de vie des classes ouvrières, des politiques sociales et des dynamiques impérialistes. Pour surmonter ces limites, il est urgent que les écologistes établissent des alliances avec les syndicats, les mouvements ouvriers et d’autres formations politiques de la classe ouvrière qui disposent d’un levier politique beaucoup plus important, y compris le pouvoir de la grève.
Pour ce faire, les écologistes doivent mettre en avant les politiques sociales que j’ai énumérées plus haut, et qui promeuvent l’abolition de l’insécurité économique qui conduit les communautés de la classe ouvrière et de nombreux syndicats à craindre les conséquences négatives qu’une action écologique radicale pourrait avoir sur leurs moyens de subsistance. Mais les syndicats doivent aussi bouger. Cette critique ne vient pas de l’extérieur, mais de quelqu’un qui a toujours été syndiqué. Comment avons-nous pu laisser les horizons politiques du mouvement syndical se réduire à des batailles sectorielles sur les salaires et les conditions de travail, tout en laissant intacte la structure générale de l’économie capitaliste ? Nous devons renouer avec nos ambitions initiales et nous unir entre secteurs – ainsi qu’avec les chômeurs et les chômeuses – pour garantir les fondements sociaux pour tous et parvenir à la démocratie économique.
Enfin, les mouvements progressistes du centre de l’économie-monde doivent soutenir, défendre et s’unir avec les mouvements sociaux radicaux et anticoloniaux du Sud. Les travailleur·ses et les paysan·nes de la périphérie fournissent 90 % du travail qui alimente l’économie capitaliste mondiale. Les pays Sud détient la majorité des terres arables et des ressources essentielles de la planète, ce qui leur confère un pouvoir considérable. Toute philosophie politique qui ne met pas en avant les travailleur·ses et les mouvements politiques du Sud en tant qu’agents principaux du changement révolutionnaire passe tout simplement à côté de l’essentiel.
Cela nécessite un âpre travail d’organisation, de création de solidarités et d’union autour de revendications politiques communes. Il faut de la stratégie et du courage. Y a-t-il de l’espoir ? Oui. Nous savons qu’il est empiriquement possible de parvenir à une économie mondiale juste et durable. Mais notre espoir ne pourra jamais être plus fort que notre lutte. Si nous voulons de l’espoir – si nous voulons obtenir un tel monde – nous devons construire la lutte.
Lire sur Terrestres, Dominique Bourg, Philippe Desbrosses, Gauthier Chapelle, Johann Chapoutot, Xavier Ricard Lanata, Pablo Servigne, « Propositions pour un retour sur Terre », avril 2020.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire