Extraits
[...]
Le capitalisme est
- un système économique
- fondé sur la production de marchandises pour le profit,
- par l’intermédiaire de l’exploitation du travail salarié
- mais aussi par l’appropriation gratuite du travail
et des énergies déployées par toutes les forces naturelles pour
reproduire les conditions de la vie.
[...]
La stimulation et l’appropriation du tissu de la vie, la captation du travail des faiseurs de monde humains et extrahumains est la condition fondamentale du capitalisme. Cette thèse ontologique sur le devenir écologique du capital a pour corollaire une thèse historique sur l’émergence du dualisme nature-société et une thèse épistémologique sur la manière d’en faire le récit.
[...]
Repenser le capitalisme dans la nature et la nature dans le capitalisme, c’est l’idée principale du concept moorien de « double internalité ».
[...]
L’histoire écologique du capitalisme et l’histoire capitaliste de la
nature constituent ce que Moore appelle la « double internalité ».
Le capital émerge à partir de réalités bio-géo-physiques (des corps
humains, des énergies fossiles, de l’eau, du vent, etc.) et la nature
elle-même semble intériorisée par le capitalisme.
[...]
Pour penser l’unité commune de cette double internalité, Moore forge le concept d’oikeios, qui désigne un ensemble de flux et d’écosystèmes à partir desquels et au travers desquels les pratiques humaines se déploient. L’oikeios, c’est la totalité englobante du capitalisme et du tissu de la vie, des tendances écocidaires du capital et de l’habitabilité des faiseurs de monde humains et extrahumains.
[...]
Une pensée dialectique suppose précisément que les entités distinctes de la nature et de la société soient posées, dans leur différence, par la relation qui les unit. À cet égard, l’unité apparaît comme le résultat d’une relation processuelle qui fabrique de la différenciation.
La domestication en serait un bon exemple. Il s’agit d’une relation qui fabrique de la différenciation entre la nature domestiquée et la nature « domestiquante » et qui, par cette relation différenciante, constitue un type d’unité hiérarchisée entre les vivants humains et autres qu’humains.
[...]
La mondialité de la catastrophe écologique n’apparaissait plus comme l’effet tardif de l’industrialisation de l’économie fossile en Europe mais comme la matrice du développement du capitalisme depuis son origine coloniale.
[...]
Moore ne tombe cependant pas dans le piège qui consiste à traiter la
production et la circulation des marchandises comme deux sphères
économiques distinctes mais cherche au contraire à penser « le procès
d’ensemble de la production capitaliste11 ».
C’est la raison pour laquelle il adopte une perspective relationnelle
sur l’espace social. Les lieux ne sont pas des points discontinus dans
un espace vide et homogène mais doivent au contraire être pensés à
partir des relations qui les constituent. Selon lui, l’espace est le
produit d’un ensemble de rapports entre les humains et la nature et
médié par des techniques d’appropriation et d’usage12.
[...]
Moore élabore le concept de « frontière marchande » (commodity frontier), qu’il reprendra dans la plupart de ses travaux ultérieurs13. À la différence du concept de border, celui de frontier n’indique pas une limite absolue, une séparation linéaire matérialisée par la représentation d’un trait sur la carte ; il désigne plutôt une zone, un espace de conquête à la limite du territoire souverain de la nation
[...]
Comme l’écrit Moore, « un volume relativement faible de capital, soutenu par une puissance territoriale [coloniale], permet de s’approprier un grand nombre de dons de la nature15 ». Le trait fondamental de l’économie coloniale de la frontière marchande est donc sa capacité à « maximiser la productivité du travail par l’appropriation [gratuite] des natures biophysiques et humaines16 ». Elle réoriente toute l’écologie d’une région pour la mettre au service de la production de marchandises pour le profit. Ce faisant, l’exploitation raciste d’une force esclave noire, la destruction des écosystèmes par la monoculture intensive et l’accumulation de capital fonctionnent ensemble comme matrice de l’écologie-monde moderne.
[...]
Pour le dire plus simplement, ce n’est pas l’Anthropos, l’humanité en tant qu’espèce, qui est responsable du désastre environnemental mais le capitalisme en tant que système d’appropriation généralisée du travail et des forces de la nature qui repose sur la propriété privée des moyens de vivre par la classe capitaliste.
[...]
[...]
Les causes de la catastrophe écologique s’enracinent dans l’histoire
globale du capitalisme. Voilà une thèse en apparence consensuelle mais
qui engage en réalité une controverse avec deux positions dominantes
dans l’écologie politique contemporaine. La première, qu’on qualifierait
volontiers de « latourienne », refuse le concept de « capitalisme » au
motif que la réalité qu’il désigne serait introuvable. En apôtres
pragmatistes de Kant, les saint Thomas « capitalosceptiques » affirment à
qui veut l’entendre que n’existe que ce dont on peut faire
l’expérience, et que personne n’a jamais fait l’expérience d’une
totalité. Ce à quoi Jason Moore répondrait que la vie moderne est une expérience
historique mondiale : l’expérience des esclaves noirs dans les
plantations ou des ouvrier·es blanc·hes d’Europe dérive de relations à
une nature transformée par la révolution scientifique, d’une division
internationale du travail, de flux de marchandises et de capitaux, de la
mise en place d’un système raciale, d’une discipline du travail, de
politiques impériales, bref d’un système-monde ou d’une écologie-monde
qui ne se limite certainement pas à ce que la description de faits
atomisés peut offrir.
[...]
Les manières de s’approprier ou de transformer l’environnement changent les rapports sociaux. S’il faut repenser le capitalisme à partir de son histoire écologique, encore faut-il être prêt à repenser la nature à partir de son histoire sociale.
[...]
Il avance que l’idée d’une nature inerte, objective, extérieure aux sociétés humaines correspond à une construction qui se répand à partir d’un ensemble de pratiques de quantification et de mesure. Cette nature extérieure, quantifiable et appropriable, il l’appelle « nature sociale abstraite ».
[...]
La nature sociale abstraite désigne donc à la fois l’ensemble des dispositifs techniques permettant la mise en équivalence généralisée des biens naturels (de la cartographie à l’établissement d’unités de poids et de mesures) et le résultat symbolique de cette marchandisation.
[...]
Suivant une thèse déjà défendue en histoire environnementale, notamment par William Cronon, les natures sont donc multiples et historiques. Pourtant, cette thèse se développe parfois dans une confusion entre des propositions ontologiques différentes et qui gagneraient à être distinguées.
[...]
Selon Moore, l’accumulation du capital ne peut fonctionner que selon une double logique de « capitalisation de la production » et d’« appropriation de la reproduction ». La capitalisation suppose l’exploitation capitaliste du travail humain, seul producteur de survaleur, et la marchandisation des forces naturelles. L’appropriation désigne au contraire une manière d’accumuler des conditions de reproduction nécessaires à la valorisation sans rémunération ou sans paiement du travail/de l’énergie fournis par la nature, humaine et non humaine.
[...]
La notion de Nature bon marché désigne l’ensemble des forces naturelles
et des stocks de ressources qui peut être approprié à des coûts
suffisamment bas pour favoriser l’accumulation du capital. La principale
contradiction écologique du capitalisme provient du fait qu’il a besoin
de Natures bon marché mais qu’il épuise en même temps la possibilité de
les reproduire26.
Ou bien les natures historiques sont détruites, annihilées par la
logique extractiviste du capital, comme dans le cas d’écosystèmes
effondrés (les îles de Madère constituent l’un des premiers exemples
historiques, désormais nombreux, d’un tel effondrement colonial), ou
bien la nature continue à fournir du travail/de l’énergie mais à un coût
qui ne permet plus l’accumulation de valeur.
[...]
Dans Comment notre monde est devenu cheap, paru en français en 2018, Jason W. Moore et Raj Patel recensaient désormais « sept choses cheap » : la nature, l’argent, le travail, le soin, la nourriture, l’énergie et les vies humaines.
[...]
Pour le capital, la nature est l’ensemble des réalités qui, n’ayant pas de valeur, sont disponibles pour l’appropriation.
[...]
« Wall Street est une manière d’organiser la nature27. » Cette formule provocatrice résume la thèse la plus originale de Moore dans l’écologie politique contemporaine. Elle signifie qu’un mode de production, une société technique ou une civilisation matérielle émergent toujours à partir du tissu de leurs relations avec des natures historiques.
[...]
En d’autres termes, le capitalisme n’a pas une écologie, il est une écologie, un ensemble de processus, de flux de matières et d’énergies ayant sa place au sein d’une totalité entropique, le tissu de la vie, l’oikeios. L’écologie-monde du capital réoriente en permanence les flux de matière et d’énergie au service de l’accumulation de valeur, elle façonne des environnements et des milieux autant qu’elle les annihile. Le capital n’est pas qu’un destructeur de monde, il est aussi un faiseur de mondes appauvris et de travailleurs·ses aliéné·es.
[...]
La perspective stratégique la plus adéquate à la pensée de Moore est peut-être à chercher du côté de l’opéraïsme écologique de Léna Balaud et Antoine Chopot : si l’accumulation du capital suppose la mise au travail de toutes les forces naturelles, la stratégie qui s’impose est celle du refus du travail. La grève écologique des forces productives du capital serait la tactique essentielle du communisme de la vie.

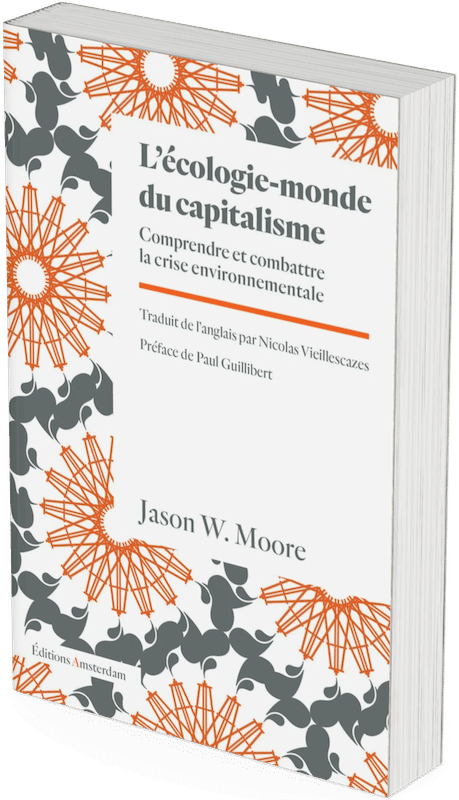
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire